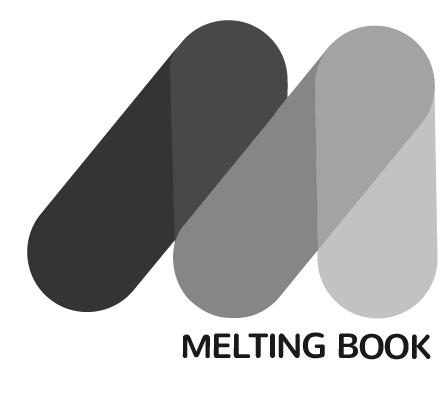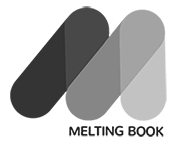Le temps béni des boîtes de nuit (de banlieue)
Une certaine époque. Dans les banlieues, beaucoup ont foulé le dancefloor sur des morceaux venus des Etats-Unis. Cameo, Midnight Star, Delegation ou Shalamar pour paraphraser IAM. En Ile-de-France, au Fun Raï ou bien avant au Pacific, une certaine jeunesse ostracisée s’est amusée. Loin du centre de Paris. Parce qu’à la périphérie, l’allégresse a une autre saveur. Retour sur une époque qui a toujours beaucoup à nous dire.
Une échappée insouciante
C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ni tout à fait La Bohème, ni tout à fait Montmartre. Tout se passe à la périphérie de la capitale et des cœurs de ville si prisés. Si fermés aussi à une jeunesse qui trépigne pourtant, à l’idée de s’amuser, de libérer cette chère sérotonine, le temps d’une échappée insouciante.
C’est en banlieue que la scène se déroule. Non pas dans le présent, noyé dans la vie virtuelle, mais dans les souvenirs de ceux qui ont connu ces des boîtes de nuit. Prenez le Niagara, célèbre night-club de Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise), le Fun Raï à Evry (Essonne), le Pacific à Puteaux (Hauts-de-Seine), devenu le Midnight.
Ces noms, aujourd’hui, passés de mode racontent pourtant une époque des quartiers populaires et la façon dont une partie de sa jeunesse s’est bâtie des espaces d’expression et de loisirs, en marge des centres.
Et pour capter, à nouveau, cette atmosphère particulière, Leila, 38 ans, a recours à une petite madeleine de Proust.
Walkman, Tam Tam ou Air Max
« Branchez, donc, un son de l’époque. Yvette Michelle avec son mémorable Everyday and Everynight ou encore le fameux Hip Hop soul party du DJ Cut Killer », s’amuse-t-elle. Reminiscence.
Comme elle, d’autres quarantenaires en savent quelque chose. Auteur de polars à succès, Rachid Santaki revient sur cette époque avec délectation. Avec ironie, aussi.
« J’avais un magazine urbain il y a quelques années et je m’étais amusé à revisiter des objets pour raconter cette époque des années 90 ». Walkman, Tam Tam ou Air Max, « la rubrique marchait bien car les lecteurs retrouvaient une atmosphère, des souvenirs…», explique-t-il.
S’il ne se morfond pas dans une forme de nostalgie, Rachid Santaki lance en 2009 un blog, « Mec à l’ancienne » avec un objectif comme il l’écrit, « vous faire voyager dans le temps ».
Le Fun Raï
On est en 1995. Et les réseaux sociaux n’ont pas encore emporté le réel sur leur passage. Ni imposer ce règne de l’instantanéité, dans lequel la notion de souvenir s’évanouit avant même d’éclore. Son blog offre, alors, au jeune homme, originaire de Saint Denis, une certaine notoriété. L’un de ses textes consacre un haut lieu des boîtes de nuit de banlieue, Le Fun Raï.
L’Essonne, le bout du monde quand on vient du Val d’Oise ou de Seine-Saint-Denis.
Rachid Santaki écrit, d’ailleurs : « Au départ, l’Essonne je pensais que c’était à l’étranger car pour y aller, il fallait une voiture avec un plein. Désolé pour les gens du 91, mais franchement c’était la mission pour aller chez vous. »

C’est un fait, ces lieux, assimilés par certains à des lieux de débauche, ont poussé à la mobilité une poignée de cette jeunesse. Certes, de banlieue à banlieue, mais tout de même.
Beaucoup aujourd’hui peinent à faire ce pas ? Dernièrement, lors d’une discussion avec des adolescents des Yvelines, l’on pouvait entendre : « Non, Paris. Je n’y vais pas trop… ».
Avec un Pass Navigo dézoné le week-end, ils peinent à s’approprier le centre, préférant, pour la plupart rester en retrait. Quitte à réinventer leur propre centre de gravité. Comme ce fut le cas dans les années 90 avec ces lieux nocturnes.
“Ces boîtes nous ont permis de sortir des cités”
Samir, 40 ans, garde cette époque bien en tête. Aujourd’hui, consultant en affaires, il livre une analyse complémentaire à celle de Santaki. « Ces boîtes nous ont permis à un certain niveau de sortir de nos cités », constate-t-il.
Comme R.Santaki, « on n’hésitait pas à prendre la voiture et faire des kilomètres pour aller s’amuser ». S’enjailler comme disent les Millenials (ndlr : s’amuser, s’éclater, passer du bon temps, prendre du plaisir serait un néologisme ivoirien.)
Une façon comme une autre de se « socialiser » et de rompre une forme d’isolement des quartiers. Samir regrette cette période, d’autant, qu’ « il y avait une forme de mixité. On avait des gens des banlieues, mais c’était ethniquement mixte car dans les cités, tu avais différentes populations », abonde-t-il.
Ces établissements favorisaient la mobilité, pour aller voir la couleur de l’herbe, ailleurs.
La nuit éclaire mieux le jour
L’étude de la nuit et la façon dont les banlieues se l’approprient, dit beaucoup de la société française de l’époque. Or, peu de recherches viennent éclairer ce pan de la sociologie. D’abord, il existe « un véritable vide conceptuel et méthodologique » autour de la nuit, souligne Jacques Galinier, directeur de recherches CNRS au Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC). Un vide qui s’étend, par capillarité, au monde de la nuit vécu par les habitants des banlieues.
Le géographe Luc Gwiazdzinski, du laboratoire Politiques publiques, actions politiques, territoires lui, va plus loin, parlant de la nuit comme d’un « impensé », à la fois pour la recherche mais aussi pour les politiques publiques. La nuit, les fantômes du jour apparaissent avec clarté.
Selon Jacques Galinier, « le sens commun voit la nuit comme l’obscurité, le vide, le néant ». Une erreur. « La nuit est un véritable chantier d’innovation et d’action. C’est là que ça bouge. La nuit a beaucoup de choses à apprendre au jour », affirme Luc Gwiazdzinski. Ainsi, la nuit fonctionne comme une diapositive permettant de révéler les rouages de nos sociétés.
La nuit comme remède
Par-delà l’épicurisme associé au Fun Raï décrit par R.Santaki, ces espaces racontent en premier lieu une histoire de l’exclusion et des discriminations.
D’ailleurs, Luc Gwiazdzinski le rappelle bien : « Les injustices sont beaucoup plus criantes la nuit ; l’exclusion, celle des SDF par exemple, est bien plus terrible la nuit. » Justement, la question des discriminations subies par les « jeunes » citoyens des cités a été l’un des leviers d’action de la très controversé SOS Racisme, identifié comme satellite du parti socialiste.
Dès la fin des années 90, l’association procède au testing à l’entrée des boîtes de nuit des centres ville. Paris, Toulouse ou Montauban. Les constats sont les mêmes. Pour les Français « d’origine », certaines boîtes de nuit restent closes.
Or, 20 ans, après ces premières actions, l’association, consciente du potentiel médiatique poursuit ce genre d’actions sans s’attaquer aux causes profondes. Entre temps, dans ces mêmes quartiers, l’émergence des boîtes de nuit, confirme certes l’exclusion institutionnalisée dans les clubs parisiens, mais illustre, aussi, cette résilience de ce type de population.
Ces boîtes de nuit ont été une réponse pragmatique au rejet organisé des classes populaires et « immigrées » par les milieux privilégiés. Le Fun Raï fut bien un objet d’organisation et, donc, d’émancipation. Difficile, donc, de ne pas y voir une démarche politique, même inconsciente.
« On y allait pour s’amuser, pas pour faire de la politique. Mais, forcément on savait que l’on était là parce que tu pouvais pas aller dans les lieux huppés de la Capitale. Elles palliaient, donc, au fait que certains étaient exclus du microcosme parisien », analyse Rachid Santaki. Et « tout cela créait une forme d’entre-soi », poursuit-il. Né de ces discriminations.
Contre-culture
Un entre-soi teinté alimenté par la naissance d’une contre-culture venue, beaucoup le savent, des États-Unis. « Il y avait l’exclusion, mais la principale raison était aussi le son qui passait dans ces boîtes », se souvient Rachid Santaki. « On y allait pour le Funk ou la New Jack, un genre musical qui dominait uniquement dans ces endroits ».
Fin connaisseur du rap, le sociologue Karim Hamou anime le blog dédié à ce courant artistique.
Dans un article « Danser à Paris dans les années 70 et 80 », il dresse une cartographie de la fête à Paris pour comprendre ce que ces lieux d’expérimentations festives disent de la société. Il cite le propos de Bernard Bacos, auteur de « Paris branché des années 70 » :
“Le premier disque de rap que j’ai entendu, en dehors des Last Poets en 69, c’était ‘Rappers’delight’ par Sugar Hill Gang et je me souviens que c’était à l’ouverture de la Main Jaune en 79, une boîte porte de Champerret où on dansait en rollers skate”.
Fréquentée les après-midi par des jeunes adolescents de cité, la Main Jaune devient rapidement une référence en matière de sons. Santaki, sur son blog, égrène la liste des morceaux devenus les hymnes d’une époque révolue mais déterminante dans l’affirmation spontanée d’un esprit « quartiers. »
Believe in love de Teddy Pentergrass, Aaron Hall ou encore Shalamar. Des artistes, tous venus des USA, déjà reconnus aux USA et qui profitaient d’un nouvel élan grâce à ce nouveau public français.
Une partie des Français de l’immigration a été biberonné au soft power américain, de James Brown à Starsky et Hutch en passant par Michaël Jackson.
À l’ombre de la France
Ces boîtes de nuit dévoilent, en creux, le rapport à une société française rétive à la différence. Incapable de chérir une jeunesse iconoclaste, née un peu hasard sur son territoire, au gré des soubresauts de l’Histoire, elle nourrit, envers elle, une forme de révulsion qui se poursuit toujours, aujourd’hui.D’ailleurs, preuve de la symbolique portée par ces établissements- des jeunes Maghrébins qui s’amusent entre eux-, deux de ces établissements seront visés par un attentat, (terme utilisé par le journal Libération pour qualifier les faits), le même jour.
Le 25 mai 1995, tout comme le Triangle à Andilly (Val d’Oise), le Fun Raï est cible d’une attaque à la bombe. Les enquêteurs n’excluent pas la piste du règlement de compte même si, selon un fonctionnaire de police de l’époque, “il n’y pas de trafic de drogues apparent”.
Les deux adresses brassent chaque week-end, des centaines de clients et « accueille en majorité des enfants de l’immigration maghrébine ».
Un point commun qui pousse les autorités à envisager la piste politique. Un agent de police révèle, dans les colonnes de Libération, l’existence de “menaces islamistes sur le milieu du raï en France”.
Les deux engins explosifs qui explosent en semaine ne font, alors, aucun blessé.
Lieux d’amusements, ces boîtes de nuit de banlieue racontent, finalement, ce que notre société française n’est (toujours) pas. Un espace d’intégration inclusif. Elles disent aussi autre chose. Ces boîtes de nuit illustrent, de manière imparable, une faculté propre aux marges.
Réinventer leur place dans une société gênée par leur présence. Et comme le racisme structurel se régénère, pas étonnant de voir émerger d’autres espaces « réconfortants » pour ces populations.
Les chichas, nouveau rapport à la nuit
Apparues au début à la fin des années 90, les chichas peuplent, désormais, la capitale mais aussi les banlieues. Fumer le narguilé, se retrouver avec ses semblables, très vite, les chichas deviennent le lieu à la mode pour la jeunesse des quartiers.
Comme le rappelle Delphine Pagès-El Karaoui, maître de conférences en géographie à l’Inalco, « en 2008, l’interdiction de fumer dans les lieux publics a freiné cet essor. »
« La géographie des cafés chichas ne coïncide donc pas avec celle des lieux de résidence des populations immigrées. »
Delphine Pagès-El Karaoui
Si un tiers des établissements a fermé, d’autres se sont accommodés à la législation, préférant composer avec une forme d’illégalité, quitte à s’acquitter d’une contravention.
Selon Delphine Pagès-El Karaoui, les chichas sont devenues, au fil des années, des « lieux de sociabilité pour les jeunes issus de l’immigration ou non. »
Ersatz des boîtes de nuit, les chichas rassemblent une clientèle issue, également, « des classes moyennes », en quête « de lieux d’insertion » dans les cœurs de ville. Parfois pointés du doigt comme des lieux peu recommandables, les chichas font, aujourd’hui partie, du paysage de la nuit populaire.
Et au-delà de l’amusement, elles permettent à ses usagers venus des cités, d’« échapper à l’image du ghetto dans laquelle la société française semble vouloir les enfermer ».
Nouvelle parade à l’ostracisation des quartiers, les chichas ont pris le relais des boîtes de nuit. Avec une différence de taille. Les chichas incitent la clientèle des quartiers à la mobilité, non plus de banlieue à banlieue mais vers Paris ou les centres-villes.
Selon Delphine Pagès-El Karaoui, « la géographie des cafés chichas ne coïncide donc pas avec celle des lieux de résidence des populations immigrées. »
On y apprend, ainsi, que « plus des deux-tiers des cafés chichas sont implantées dans Paris intra-muros, avec des îlots identifiés comme la place de Clichy et les rues Mouffetard et Oberkampf. »
Une nouvelle configuration qui emprunte beaucoup à l’imaginaire de l’Orient-Egypte- ou du Maghreb-Marrakech. De cet enchevêtrement des cultures jaillit, comme par le passé, une façon bien française de vivre les identités hybrides.
Par Nadia Henni-Moulaï