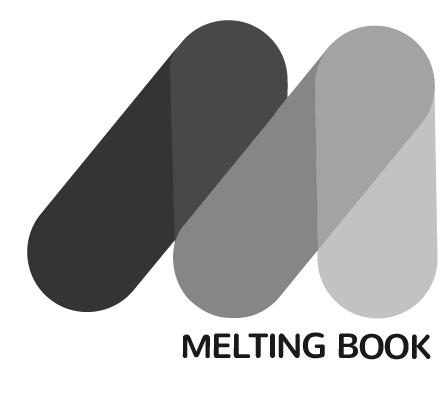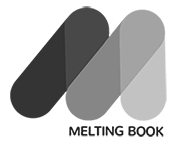Henry Laurens : “Les Israéliens n’ont aucun intérêt à faire évoluer la situation”
Date de première publication le 15 mai 2017
Henry Laurens, professeur au Collège de France, pense le Moyen-Orient comme un système géopolitique où se déploie « un jeu permanent d’ingérences et d’implications entre les acteurs locaux, régionaux et internationaux ».
Effondrement des États, impasse israélo-palestinienne, tensions sunnites-chiites, regain d’une opposition Russie–États-Unis, règne des milices qui s’engouffrent dans ces désaccords politiques synonymes de saccages.
Y a-t-il même une syntaxe des relations internationales propres au XIXe siècle, avec le retour dans la région de la Russie, une Turquie à la nostalgie toute ottomane, le cycle de conférences de paix hâtives tentant d’apporter leur solution, les rivalités diplomatiques et militaires multiples ?
Penseur du temps long, de la respiration historique profonde, Henry Laurens observe le « grand jeu » moyen-oriental, dont il livre ici quelques clés utiles.
En Israël/Palestine, vous parlez de « paix impossible ». À quoi s’attendre dans les prochaines années ?
Henry Laurens : À rien. Autant dans la décennie des années 1990, il y avait une fenêtre d’opportunité pour arriver à un règlement de paix, autant aujourd’hui, il n’y a aucune condition particulière pour cela, même si Donald Trump a donné l’apparence de vouloir lancer de nouvelles initiatives.
Mais les faits sont têtus. La progression de la colonisation ne permet pas de constituer un État palestinien homogène. Pour quelles raisons, dès lors, les Palestiniens accepteraient-ils un archipel de lieux complètement isolés ?
Pour reprendre l’expression de Raymond Aron, qui qualifiait la guerre froide de « paix impossible, guerre improbable », est-ce une situation où la paix est impossible, comme vous le dites, et la guerre toujours probable ?
H. L. : C’est là un conflit de basse intensité comme il y en eut dans l’Histoire auparavant. En Irlande par exemple. Par définition, ces conflits de basse intensité peuvent durer très longtemps.
À moins d’un bouleversement régional, pour l’instant, il ne faut s’attendre à rien. Le processus de paix est devenu au final un processus sur le processus. Sur la paix elle-même, rien n’est rassurant.
Les Israéliens n’ont aucun intérêt à faire évoluer la situation car elle leur profite complètement. Ils sont isolés de l’essentiel de la population palestinienne.
Ils font payer la charge de l’administration des territoires occupés à l’Autorité palestinienne, c’est-à-dire à l’Union européenne ou l’aide internationale.
Au-delà de cette situation qui leur profite largement, il y a l’aspect mystique, messianique, au sens politique du terme.
Un ministre israélien a encore déclaré récemment que la Bible est la preuve que toute la terre d’Israël leur appartient. Ces affects religieux s’ajoutent donc à la question politique. Or, il est plus facile de céder sur le politique que sur le religieux.
Les Palestiniens ont pour eux le droit, mais ils n’ont pas la force. Les Israéliens ont pour eux la force, mais ils n’ont pas le droit. Les premiers ne peuvent transformer leur droit en force et les seconds leur force en droit. L’impasse est pour le moment durable.
L’administration Trump donne tous les signes d’un alignement sur la politique nationaliste et religieuse du gouvernement Netanyahou. Que peut-on en attendre ?
H. L. : Les Israéliens s’attendaient à ce que les États-Unis leur donnent leur bénédiction sur l’extension des colonies, c’est plutôt le message inverse qui leur a été envoyé par Washington ces derniers jours.
Mais concrètement, dans les faits, Donald Trump n’y connaît rien. Il annonce qu’il veut faire « un deal », mais si on était dans une logique de deal, on y serait arrivés dans les années 1990, lors du processus dit d’Oslo.
Donald Trump reprend, au final, ce qu’a fait Barack Obama. Il y a des contraintes dont il commence à tenir compte. Au fond, je note plus une continuité qu’une rupture entre l’administration Obama et celle de Trump.
Quant à l’annonce du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, c’est un rituel diplomatique américain. Tous les ans, le Congrès fait une recommandation demandant le transfert.
C’est aussi une question régulièrement posée par les candidats à l’élection, qu’ils finissent par oublier une fois élus.
Quand Benyamin Netanyahou déclare qu’il ne négociera pas tant que les Palestiniens ne reconnaîtront pas le caractère juif de l’État d’Israël, qu’est-ce que cette notion signifie ?
H. L. : C’est une question de légitimité. Les Palestiniens ne pourront pas reconnaître qu’Israël est un État juif, car cela justifierait leur expulsion.
Ils peuvent reconnaître qu’il existe un État juif, qu’il existe un peuple juif en Palestine, mais ils ne peuvent pas reconnaître la légitimité du sionisme car ce serait reconnaître comme légitime leur expulsion d’une grande partie de leur pays.
De plus, Benyamin Netanyahou joue sur les mots : Israël n’est pas l’État juif, mais l’État du peuple juif, ce qui n’est pas la même chose.
Il faut un retour à l’Histoire pour trouver une formule qui montrerait que le mouvement sioniste a porté tort à la population palestinienne, ce qui ne suppose pas automatiquement un droit au retour.
Cela avait été envisagé au Sommet de Taba en janvier 2001. On prenait en compte pour la première fois l’importance des « narratives », ou la théorie du récit.
Comment jugez-vous la position française ? La France a été critiquée tant par les Israéliens que par les Palestiniens lors de l’initiative de la Conférence de Paris en janvier dernier.
H. L. : À l’aune de l’Histoire, la position gaullienne souhaitait au final sauver les Israéliens d’eux-mêmes. Pour de Gaulle, puis pour Pompidou, il fallait qu’Israël évacue les territoires occupés pour obtenir la paix. En cela, on ne peut pas dire que la position française ait été pro-arabe.
Ce sont les pays arabes qui se sont alignés sur la position gaullienne et non l’inverse, au bout d’un certain nombre d’années.
Sous Giscard puis Mitterrand, car il y a eu entre les deux une forme de continuité, la France se pensait comme ayant un rôle pédagogique, consistant à habituer les acteurs à une reconnaissance mutuelle et à une solution à deux États. C’est le sens du discours de Mitterrand à la Knesset en mars 1982.
Aujourd’hui, il n’y a plus rien de cela. Nous sommes dans des conjonctures politiques exécrables, déjà dans la région moyen-orientale, mais aussi en Europe.
Certains esprits réalistes considèrent que cela ne pourra évoluer qu’en exerçant des pressions sur Israël, et particulièrement sur les colonies. Il est admis que ces colonies sont illégales, mais ces pressions supposent-elles de faire interdire les produits qui en proviennent ou de les marquer de façon distincte ?
Sur les gouvernements français, car il n’y a pas d’opposition droite-gauche sur le dossier, pèsent aussi la question de l’antisémitisme et la relation qui s’est bâtie entre les communautés juives européennes et l’État d’Israël.
Il y a aussi les calculs électoraux.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, a rompu ses relations avec Lafarge [l’entreprise franco-suisse avait un temps envisagé de participer à la construction du « mur Trump » au Mexique], mais elle serait plus ennuyée d’interdire à la même entreprise de vendre du ciment aux colonies israéliennes.
Au-delà de la Palestine, la grille de lecture apposée au Moyen-Orient tient à un affrontement chiites-sunnites, que ce soit au Yémen, en Syrie ou en Irak. Cette grille de lecture est-elle totalement valable ?
H. L. : Elle est réelle. Mais dans le moment historique dans lequel nous nous trouvons actuellement.
Au XIXe siècle, la différence chiite-sunnite a eu tendance à s’amoindrir fortement.
Une sorte d’œcuménisme musulman a existé, qui posait par exemple que le chiisme duodécimain (rite jafarite) est la cinquième école juridique de l’islam sunnite.
Toutefois, nous observons désormais les conséquences de la formation d’un chiisme politique, lequel, au départ, n’avait pas de relation avec le sunnisme politique.
Dans les pays comme l’Irak ou le Liban, les chiites, considérés comme déshérités, formaient la masse des militants des partis communistes.
C’est pour cela que les grands dignitaires chiites se sont lancés dans le politique et le social. Ce n’était pas pour contrer le sunnisme politique, mais pour combattre l’influence des partis communistes.
Les choses ont changé avec la République islamique d’Iran et son ambition d’une révolution islamique mondiale. Cette ambition n’a pris que dans les milieux chiites.
Le djihadisme, tel qu’il s’est développé en Afghanistan, a pris une tournure violemment anti-chiites, ce qui s’est retrouvé dans le djihadisme international des années 1990.
Téhéran avait tenté d’atténuer cela, au début des années 2000, en donnant une dimension plus islamique et moins chiite à son système d’alliance. Il avait ainsi établi une alliance avec le pouvoir alaouite syrien, avec le Hamas [sunnite] de Gaza.
Après 2011, avec la guerre syrienne, le clivage est désormais essentiel. Le soulèvement a été celui d’une population à majorité sunnite contre un pouvoir qui n’apparaissait plus comme exprimant un intérêt général.
Il est désormais incontestable qu’il y a une opposition chiite-sunnite qui regroupe une opposition arabe-iranienne. Même si cette dernière est totalement fausse. C’est un héritage de la pensée orientaliste du XIXe siècle qui faisait du chiisme un produit proprement iranien et du sunnisme un produit totalement arabe.
Daech s’inscrit donc parfaitement dans ce clivage ? Et que penser des ingérences extérieures ?
H. L. : Daech a joué de ce clivage. C’était déjà la stratégie d’al-Zarkaoui [ancien chef d’al-Qaïda en Irak] de provoquer une guerre confessionnelle pour faire exploser la société irakienne, même si, alors, Ben Laden n’était pas d’accord. Daech est l’héritier d’al-Zarkaoui.
Il faut bien comprendre que le Moyen-Orient n’est pas une donnée géographique mais une donnée géopolitique. On y trouve un jeu permanent d’ingérences et d’implications entre les acteurs locaux, régionaux et internationaux.
Toutes les puissances qui deviennent importantes pensent pouvoir y jouer un rôle car elles y ont aussi des intérêts.
Le jour où on ne parlera plus de Moyen-Orient mais d’Asie occidentale, comme dit l’ONU, cela voudra dire que la région sera pacifiée et ne sera plus l’enjeu d’influences extérieures.
L’action principale de ces forces extérieures est d’empêcher que l’un des acteurs locaux devienne dominant.
Ces mêmes puissances locales font aussi appel aux puissances étrangères pour empêcher l’émergence d’un acteur local. Cela date de plus de deux siècles.
Que penser du retour de la Russie, que veut-elle ?
H. L. : Je n’ai pas l’impression qu’elle le sache elle-même clairement. Il faut se rappeler que la Russie est très proche géographiquement de cette région.
Le Moyen-Orient est son environnement proche. Une présence russe par éclipse se fait dans cette région depuis 1770, quand la flotte russe est entrée en Méditerranée.
Il y a aussi accessoirement le rôle que la Russie s’est donné, au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale, de protectrice des chrétiens orthodoxes de la région.
Aujourd’hui, le retour de la Russie dans cette zone lui permet de se donner l’impression qu’elle veut et peut encore assumer un rôle mondial. Elle n’y a pas en effet d’intérêt direct, notamment économique. Sauf celui de vendre de l’armement.
Cela lui fait une bonne publicité pour son armement moderne, notamment l’armement anti-aérien. Elle a aussi l’impression de participer à la grande politique mondiale, d’avoir un rôle de stratège.
Cependant, la Russie reste une « puissance pauvre », selon l’expression de l’historien Georges Sokoloff. L’économie russe est équivalente à celle de l’Italie.
Cette politique de puissance n’a pas de lien avec la réalité de son économie, d’où les sacrifices faits pour maintenir un instrument militaire qui est hors de proportion avec l’économie réelle.
Depuis que Poutine s’est lancé dans cette politique de puissance, le niveau de vie des Russes a chuté de 15 %. La Russie est-elle capable de faire de la gestion à longue durée ? Elle semble pousser à une solution à toute vitesse en Syrie pour pouvoir en sortir. Mais il ne me semble pas qu’elle pourra le faire rapidement.
Pourquoi ?
H. L. : Car il y a la réalité du terrain et celle des conférences internationales, que ce soit à Astana ou à Genève.
Sur le terrain pullulent les milices, qu’elles soient d’un côté ou de l’autre. Le régime de Bachar al-Assad n’est plus qu’un agrégat de milices. Il ne se fait pas respecter par telle milice qui contrôle telle sous-région ou telle autre.
Du côté de la révolution syrienne, se trouvent les Kurdes, les islamistes, des milices locales aussi. Il n’y a pas d’autorité centralisée qui pourrait imposer que les armes cessent. C’est ce qui est inquiétant d’ailleurs sur la longue durée.
Comment interprétez-vous, en tant qu’historien, la montée des populismes, Trump, Brexit, Front national, etc. ?
H. L. : De nombreux phénomènes se conjuguent, d’autant plus qu’il y a un populisme de droite et un populisme de gauche.
Dans la situation française, il y a l’effet de durée d’une longue crise qui date de la fin des années 1970. Le chômage a maltraité de nombreux milieux sociaux.
Il faut prendre en compte aussi les héritages coloniaux. La mémoire de l’Algérie résonne encore dans des pans entiers de la société française.
Autre phénomène, une classe politique qui ne tient pas forcément ses promesses électorales. Il y a un mouvement de remise en cause des élites, des classes supérieures, du cercle de la Raison.
Des questions identitaires restent fortes aussi. On a eu l’impression que le patriotisme, nationalisme français, avait fortement décliné. Or, c’était faux.
Il y a aussi toutes les complexités liées à l’intégration ou non-intégration des populations issues de l’immigration. Là se greffe la question de la subordination.
Si l’Autre est défini comme différent de soi-même, on le pense dans une relation supérieure ou inférieure.
Soit demeure une continuation de la posture coloniale, donc une subordination, soit, comme pour la situation actuelle, on trouve des gens issus de l’immigration qui peuvent être préfets, militaires, dans cette vaste promotion sociale réelle des gens issus de la troisième ou quatrième génération. Une classe moyenne a émergé qui est plus qu’en formation, elle est là.
Propos recueillis par Hassina Mechaï
Cette contribution a également publiée sur le site Middle East Eye.