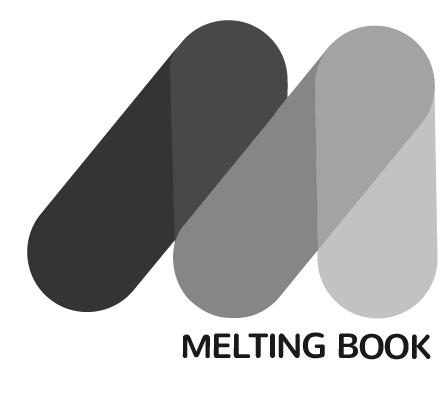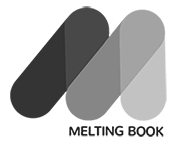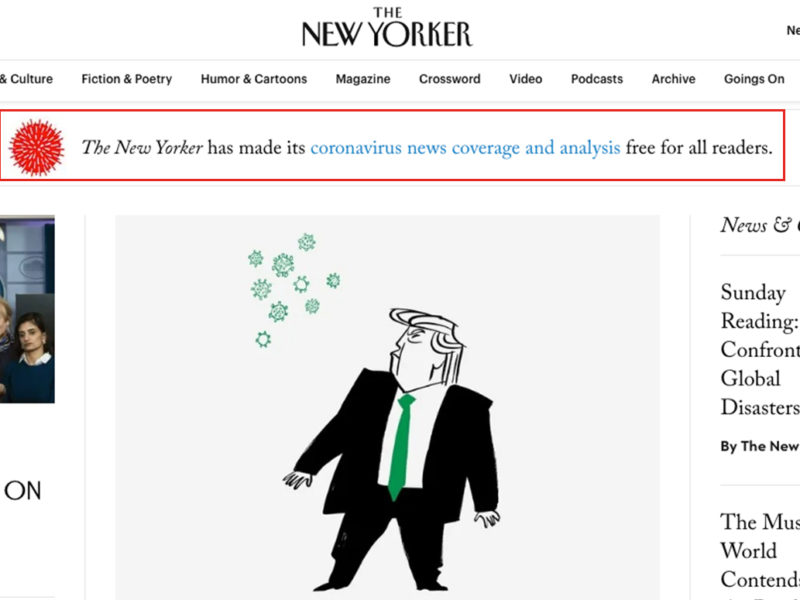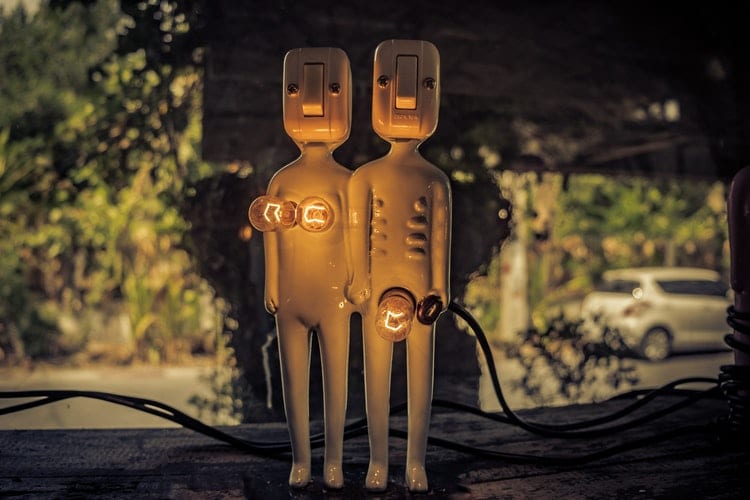
Qui doit éduquer les enfants à la sexualité ?
À qui revient l’éducation à la sexualité ? L’interrogation pourrait trivialement être balayée d’un revers de manche. Sauf que les atermoiements estivaux entre les adeptes d’une éducation sexuelle à l’école et leurs opposants ont achevé la croyance d’une approche naturelle et pacifiée du sujet.
Nombreux sont ceux à avoir goûté aux joies des vidéos WhatsApp dénonçant le projet « satanique » et « pédophile » porté, selon eux, par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes.
La jeune ministre, figure de proue médiatique du gouvernement, a, alors, multiplié les interviews, censés calmer ses détracteurs. Lors d’un live Facebook, le 29 août 2018, elle éclaircissait sa véritable intention.
« Il est hors de question d’enseigner ni la masturbation, ni aucune pratique sexuelle à des enfants, et encore moins à 4 ans », a-t-elle martelé.
Sur Europe 1, jeudi 6 septembre, elle réitère sa tentative d’éteindre un feu décidément tenace.
« Il n’y aura évidemment pas de cours à la masturbation à la maternelle contrairement à ce qui a été annoncé dans de faux documents », a-t-elle, à nouveau, confirmé.
« Je suis toujours affligée de voir que l’on est dans une société de pétitions et de tribunes », Marlène Schiappa
À la question d’Audrey Mara-Crespo sur le manque de clarté de ces séances destinées au primaire et au collège, Marlène Schiappa a répondu, un peu à la cantonade :
« On répond aux questions des enfants, bien sûr basé sur le bon sens, adapté l’âge des enfants, sans aucun contenu explicite. Est-ce que les filles ont le droit de jouer au foot… ».
Si la sexualité n’est pas le foot, pour Schiappa, « il s’agit bien de la vie affective et sexuelle et la lutte contre les clichés. C’est le respect d’autrui… », s’est-elle défendue.
« il y a des garçons qui refusent de donner la main à des petites filles à l’école, ce sont des jeunes filles qui se prostituent de plus en plus jeunes, l’accès à la pornographie… Ces séances, elles contribuent à lutter contre cela ».
Pris dans ce vortex médiatique, Marlène Schiappa et le reste du gouvernement, restent donc “droits dans leurs bottes”, prêts à avancer sur l’éducation sexuelle.
Téméraires pour certains. Condescendants face aux préoccupations formulées par des parents ou des professionnels, pour d’autres.
D’ailleurs, sur Europe 1, Marlène Schiappa, s’est agacée de cette « société de pétition » où « un pédopsychiatre » lance un appel à la contestation basée sur, selon elle, « des fake news ».
C’est quoi ces trois séances d’éducation sexuelle et affective ?
Les trois séances d’éducation sexuelle et affective seront appliquées durant l’année scolaire. Ainsi soient-ils. Seulement, après les réprobations estivales (dont il faut entendre l’écho), la source du conflit est loin d’être tarie.
Raison de plus pour revenir à l’objet de la discorde, mais surtout, d’y apporter de la perspective. Avec une question en toile de fond, qui finalement ne va pas de soi. À qui revient l’éducation à la sexualité ?
Alors si « face à la rumeur », l’action du gouvernement peut être moins audible, comment expliquer cette querelle, alors même que ces séances sont prévues par la loi Aubry du 4 juillet 2001 (article L312-16 du code de l’éducation).
Les médias l’ont bien rappelé. Tout est parti du fameux document de l’OMS, standards pour l’éducation sexuelle en Europe. Adressé aux décideurs politique, aux autorités compétentes et aux professionnelles, le document prône une approche globale de l’éducation sexuelle, fondée sur le dialogue et l’interactivité. Les auteurs espèrent, à noter, inspirer les 53 pays…
Sexualité positive
Un apprentissage nécessaire pour « développer des aptitudes essentielles qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement ».
Dans cette volonté d’éduquer et de normaliser le rapport à la sexualité, il y est par exemple question entre 4 et 6 ans de « masturbation enfantine précoce », d’«acceptation des sentiments amoureux » ou « d’identité sexuelle positive ».
En primaire, le document préconise d’informer sur « les menstruations », « l’éjaculation » ou la notion de « sexualité acceptable ». Le document pose une série de recommandations. Dans la préface du document, les auteur.e.s plaident pour « une éducation sexuelle holistique », en évitant de réduire cet apprentissage aux « risques potentiels liés à la sexualité, comme les grossesses non prévues et les IST ».
Le but étant de favoriser une sexualité « positive » déclinée par tranche d’âge. Si ce document ne pousse pas les tout petits à la masturbation, comme les fake news l’attestent, il rappelle qu’elle est une réalité sur laquelle les adultes peuvent mettre des mots en cas de questions de leur part.
Anticiper ou pas ?
C’est bien de ce point précis qu’il s’agit. La question de l’anticipation. D’ailleurs, l’OMS, en introduction, évoque « le caractère participatif » de l’éducation sexuelle telle que encouragée. Pour Maurice Berger, pédopsychiatre, souvent accusé d’être réactionnaire, le débat achoppe sur cette ligne.
« Clairement, parler avant les questionnements de l’enfant se révèle nocif », avance-t-il. « D’abord parce que tous les enfants d’une même classe n’ont pas le même niveau de développement. Ensuite parce qu’ anticiper sans savoir si l’enfant a entamé un questionnement intérieur sur le sujet peut se révéler traumatique ».
Pour le professionnel de la protection de l’enfance, il s’agit avant tout de suivre, sans bousculer, le calendrier psychologique du jeune. Un constat auquel souscrit Sonia*, assistante sociale dans deux collèges de l’est. « Aborder la sexualité avec des enfants pas prêts à recevoir ce type d’information peut s’assimiler à une intrusion dans leur psychisme », s’inquiète-t-elle.
Du terrain, où elle prend en charge tout type de famille, Sonia s’inquiète de « cette volonté d’anticiper les questionnements des jeunes ». Mais face aux jeunes, Sonia est bien consciente de l’importance d’apporter des réponses.
« Au collège, les jeunes filles et garçons, entrés dans la sexualité, ont besoin d’interlocuteurs. Ils doivent pouvoir discuter dans un cadre anonyme. Nous sommes là pour répondre quand il y a demande. Mais en aucun cas, je ne vais anticiper sa sexualité », souligne-t-elle.
S’agit-il d’adopter, alors, une attitude passive ? Car, de l’avis même de professeurs, les rapports entre les garçons et les filles dans l’enceinte scolaire n’est pas chose aisée. Surtout, en cas de conflits, les temps d’apprentissage en pâtissent.
Cet été, Mounia Feliachi, professeure de mathématiques, en sait quelque chose. « Je pense que le gouvernement ne veut rien anticiper. Il s’agit de régler des problèmes dont je suis témoin à travers mon poste d’enseignante ».
Concrètement, la jeune femme, dont la classe de collège donnait sur une cours de maternelle, parle d’agression comme « un garçon qui tire les cheveux d’une fille ou qui soulève la jupe ». Elle, militante de gauche, qui a passé son été à déconstruire les fake news, le dit clairement :
« Il y a un moment où il faut rappeler que les profs sont démunis sur ces questions. Nous avons déjà des problèmes de discipline à gérer mais quand il y a ce genre de problème, il n’est pas possible de faire le travail d’instruction ».
Et les exemples sont légion. « Dans une classe de sixième, des garçons prenaient des photos de filles en cours de sports. Les clichés ont été diffusés sur les réseaux sociaux, sans leur consentement…va bien au-delà de la sexualité. La fille concernée en a parlé, en conseil de classe, au bord des larmes », se souvient l’enseignante. Quand le consentement est malmené voire ignoré…
Consentement
C’est justement, l’un des points d’achoppement que Marlène Schiappa a pris de face cet été. Si elle a autant cristallisé les mécontentements, c’est qu’elle et sa loi paient le non-consentement des mineurs, vécu par certaines associations comme une régression voire une trahison.
La ministre avait proposé d’introduire « la présomption non-consentement ».
Une notion censée pallier aux faiblesses du Code pénal actuel qui punit de cinq ans de prison, un majeur exerçant « sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans » (article 227-25 du code pénal), associé à un délit. Découle de cet article, une majorité sexuelle, fixée tacitement à 15 ans.
L’atteinte sexuelle à distinguer du viol sur mineur, lui, qui un crime et dont la peine peut aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.
Or, sa caractérisation suppose de prouver qu’il y a eu « violence, contrainte, menace ou surprise », enfant de moins de 15 ans inclus. Avec la présomption de non-consentement proposée par Schiappa, l’idée était bien de protéger les mineurs de moins de 15 ans en associant toute violence à un viol, prouvé ou non.
Votée le 1er août dans un hémicycle parsemé, « cette grande cause du quinquennat » n’aura pas résisté à l’appel balnéaire, faut-il croire. C’est dire l’intérêt que suscite cette question dans un pays où un mineur subit une tentative ou un viol toutes les heures…(ONPE).
Promulguée le 3 août, la loi Schiappa ne porte plus la « présomption de non-consentement », sacrifiée sur l’autel d’une formulation confuse et pusillanime :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
Et pour tous les mineurs, y compris de 15 ans à 18 ans, « la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits ».
Or, les professionnels de la protection de l’enfance mais aussi de citoyens ne pardonnent pas à la ministre, et plus largement au gouvernement, cette reculade. Une trahison au regard de la situation de la protection de l’enfance, qu’ils jugent « en berne » en France.
Dans une tribune du 19 août 2018, « Loi Schiappa, la protection de l’enfance en berne », Lyès Louffok, membre du conseil national de la protection de l’enfance ou Caroline de Haas, militante féministe, dénonce un subterfuge, censé « Faire croire à l’opinion publique que cette loi pose un seuil de non-consentement pour mineurs de 15 ans ».
Comment expliquer ce consensus mou de nos gouvernants sur la question de la sanction des violences sur mineurs ? C’est ce double standard, passif sur la pédophilie, anticipateur sur l’éducation sexuelle, qui génère, en creux, une forme de confusion, terreau de la défiance.
>> LIRE AUSSI : « Ce n’est pas un combat féministe, c’est un combat pour nos enfants »
Conscientisation
Éduquer les enfants à la sexualité ne devrait-il pas, avant tout, reposer sur la conscientisation de ce qui est autorisé ou non (par la loi) ?
Or, il est évident que nos dirigeants peine à se saisir du problème des violences sexuelles faites aux enfants. Avancer le terme de « tabou » n’est pas de trop. En 2016, 150 000 tentatives ou viols ont eu lieu sur des mineurs contre 93 000 pour les femmes et 15 000 pour les hommes. Et dans ces cas de pédophilie, 4 affaires sur 10 se déroulent dans la sphère familiale.
Maurice Berger, le déplore, d’ailleurs. « Sur l’inceste, nous avons très peu progressé. Il faut le reconnaître ». Et l’expert de citer, « l’impact d’Outreau qui a été catastrophique ».
Les enfants Delay
L’un des plus grands fiascos judiciaires avait mêlé viols sur mineurs, incestes, accusations, acquittements, excuses de Chirac. Avec au centre, les enfants Delay dont les dénonciations passent, alors, à la moulinette médiatique et politique, essorées, vidées, soupçonnées. « La parole de l’enfant y a été décrédibilisée alors que 12 enfants sur 15 ont été reconnus victimes d’abus sexuels lors du procès », regrette Maurice Berger. Outreau 3, procès qui s’est tenu en 2015, avec les enfants victimes devenus adultes, n’a pas permis de lever le soupçon permanent qui pèse sur la parole des enfants.
Lorsque l’on sait que la parole des victimes aura besoin d’un mouvement mondial comme #Metoo pour émerger, qu’en est-il de celle des enfants ?
Jacques Thomet (1), journaliste à l’AFP, avait suivi l’affaire. Selon lui, avec Outreau, « on a posé un cadenas sur la bouche des enfants ». Il y a bien eu un avant et un après Outreau, où les agressions sur mineurs doivent être prouvées au moyen de traces ADN par exemple…
Symptomatique, également, la portée de la commission parlementaire initié en 2004, dans le sillage de l’affaire. Chargée de comprendre les raisons de cette bérézina judiciaire, une décennie plus tard, elle n’a pas vraiment permis de réformer la justice en la matière.
La place des parents
Les pouvoir publics peuvent-ils être de bons prescripteurs en matière de pédagogie sexuelle, pourtant nécessaire, tout en étant tièdes sur ces affaires ? Cette incohérence a un prix.
Elle disqualifie les projets d’éducation sexuelle du gouvernement, pourtant nécessaires, les ramenant à des incursions idéologiques sur les terres parentales. Parce qu’il s’agit bien d’un autre nœud.
Quelle place pour les parents dans l’éducation sexuelle ? La peur d’être dépossédé de leurs rôles apparaît bien évidemment à travers les réactions épidermiques de cet été.
Peu ont épluché les textes de loi et le document de l’OMS, se contentant de relayer des vidéos Whatsapp.
D’autant qu’il est difficile d’affirmer que les familles font le job en matière d’éducation sexuelle. Le sujet relève du tabou. Quand il y a demande des enfants, certains patinent avec des explications hasardeuses quand d’autres l’évacuent.
Résultat, les tabous persistent, la méconnaissance grandit et la frustration apparaît. Pas étonnant que 62% des 18-30 ans, déclarent « avoir vu leur première scène pornographique avant 15 ans » dont 20% entre 11 et 12 ans. (2)
Mais, ce qu’il faut percevoir à travers ces inquiétudes, outre l’impérieuse nécessité de former aux médias, c’est la nécessité de crédibiliser les actions de l’Etat sur le sujet. Or, la reculade de Schiappa ou des fiascos tel que l’affaire Outreau portent préjudices aux institutions.
Dans nos sociétés consuméristes, où la marchandisation du corps des femmes ouvre aussi la voie à celle des enfants, un Etat fort est un préalable. Il semble pourtant à la traîne pour en dénoncer les méfaits.
#Metoo, qui aura un an cet automne, en est une preuve. La parole s’est libérée, non par progressisme mais grâce aux victimes.
Le mouvement a révélé la vraie nature du rapport aux femmes dans les sociétés dites modernes, éclaboussant tous les milieux. Et l’arène politique, d’où naissent nos lois, n’est pas en reste.
D’où une question, provocatrice certes, mais légitime. Après #Metoo, qui est le mieux placé pour éduquer les enfants à la sexualité ? Certainement pas nos politiques.
Nadia Henni-Moulaï
(1) Jacques Thomet, Contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle, Kontre-Culture
(2) Sondage OpinionWay pour 20 minutes, 11 avril 2018