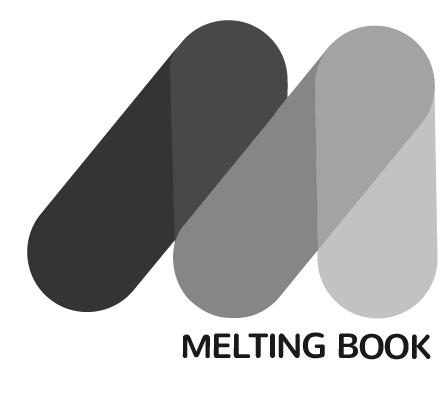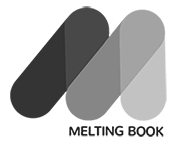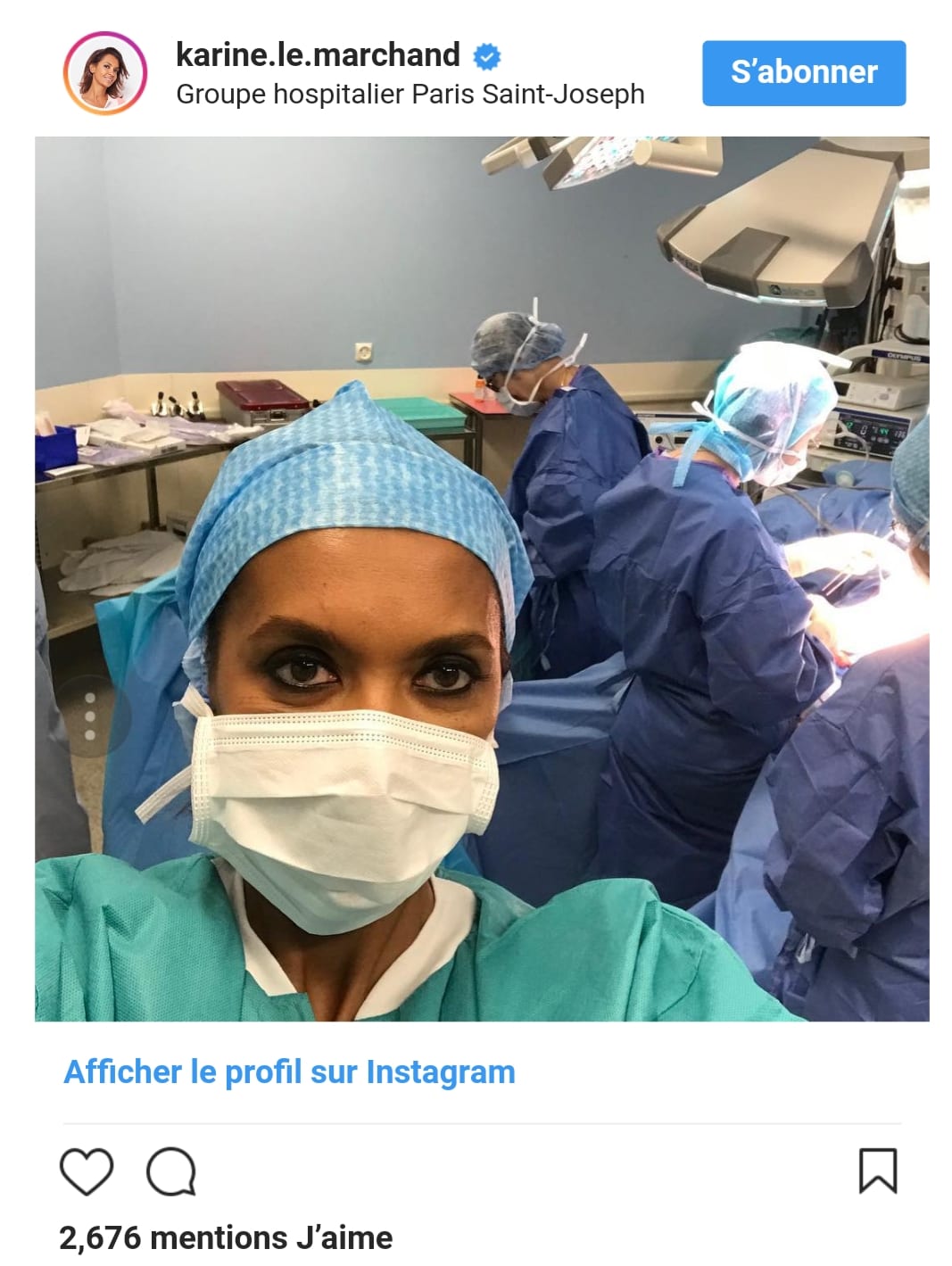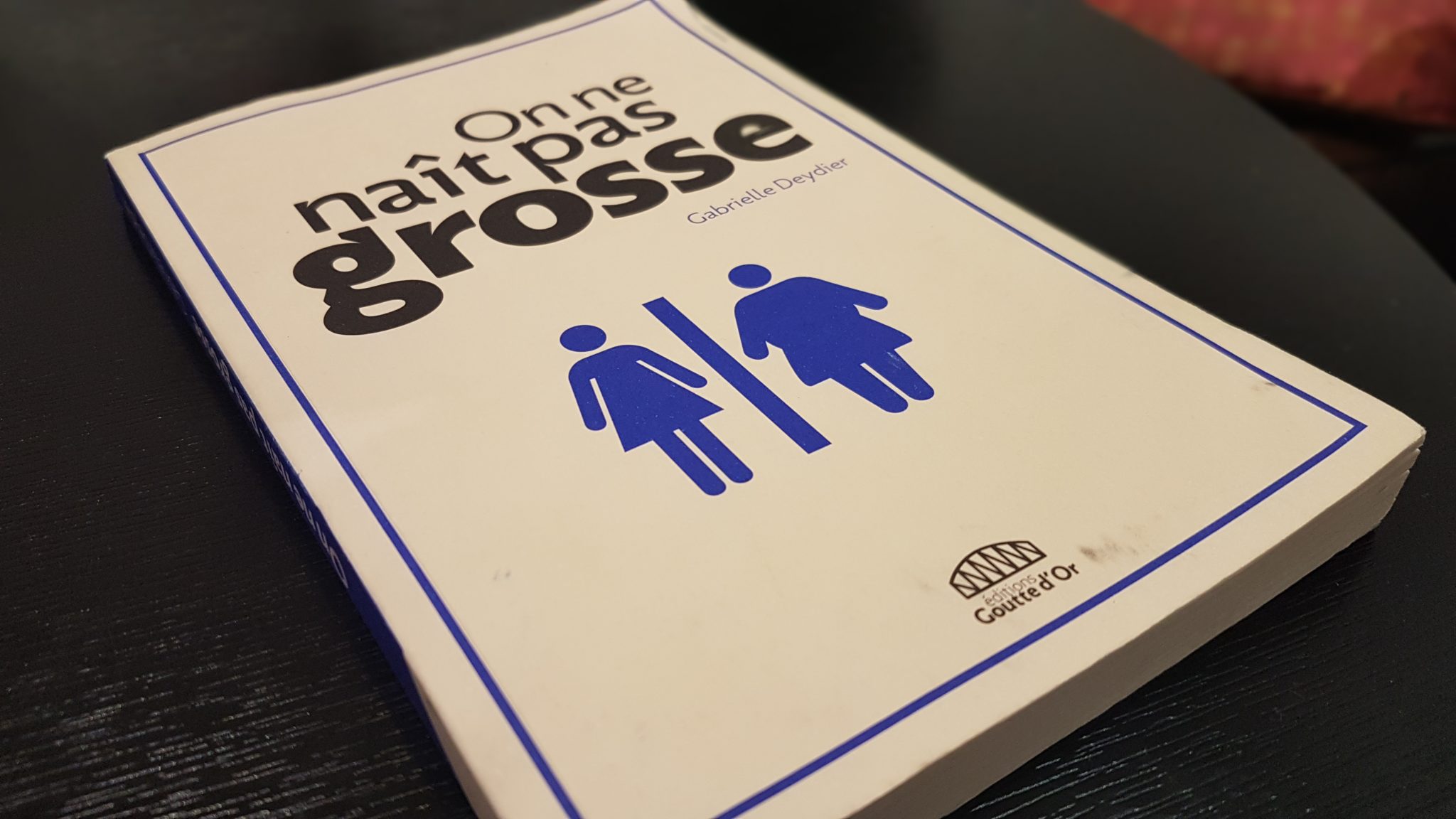
Gabrielle Deydier : Il faut dire le mot « grosse »
On ne naît pas grosse (Ed. Gouttes d’Or) de Gabrielle Deydier est sorti l’an dernier. Dans ce récit de vie, les humiliations côtoient la honte. Mais l’auteure, diplômée en cinéma et sciences politiques, émerge avec ce récit comme une figure de résilience. Un profil comme notre société excluante sait, paradoxalement, en produire.
On ne naît pas grosse. On le devient ? Surtout dans le regard de l’autre. « Dans l’absence de rêves », écrit Gabrielle Deydier. Dans son ouvrage, sorti l’an dernier (et dont elle continue d’assurer la promo), elle raconte comment ses 150 kilos ont balisé son parcours.
Des kilos en trop qui, on le comprend vite, dépasse la question de l’esthétique, sans cesse, lancée aux visages des personnes concernées en France.
Grossophobie, j’écris ton nom
On ne naît pas grosse est, aussi, un exercice d’écriture, pour Gabrielle, qui n’avait jamais relaté jusqu’ici les méandres de son parcours où la grosseur a très vite conditionné ses choix de jeunesse et d’adulte. Quitte à adopter le sacrifice comme une règle de vie. Se mettre en marge de sa vie.
« Depuis l’enfance, l’adolescence surtout, l’obèse apprend à se taire », écrit-elle, avec recul.
On ne naît pas grosse est un plaidoyer. Pas étonnant vu ce parcours semé d’embûches-discriminations- posées ici et là, à dessein, par une société qui a fixé les codes d’un Beau, arbitraire, homogène. Un moule uniforme auquel chacun doit se conformer sous peine d’en être excommunié.
Dès les premières pages de cette confession curative, Gabrielle s’érige contre les sociétés dites modernes, où la beauté des femmes est normative.
Le mal-être ne naît-il pas, comme, souvent dans le regard de l’Autre ?
« Je ne connais aucune femme qui ne se soit demandé si ses fesses ou ses seins étaient de la bonne forme, de la bonne taille », rappelle-t-elle, d’ailleurs.
Gabrielle Deydier
Autre injonction, « Certaines de mes copines complexent même à cause de la couleur de leurs mamelons »…affolant. Et toujours, un corps-celui des femmes- où se catapultent désirs et attentes, il faut bien le dire, d’un pouvoir masculin et capitalistique.
Et puis On ne naît pas grosse, raconte la résilience à travers la catharsis, celle de Gabrielle, une femme grosse, discriminée, poussée à la démission, « sans revenus, en pleine trêve hivernale »…
D’ailleurs, elle l’énonce, clairement. « Rien de tel qu’une descente aux enfers pour prendre des décisions radicales ».
Quoi de plus « radical » que d’écrire sur soi ? Que de se confier aux lecteurs, sans filtre ? Un journal intime et épique. Avec une prouesse, celle de ne jamais verser dans le pathos.
Raconter sa déchéance sociale, c’est bien de cela dont il s’agit, sans susciter apitoiement (souvent suivi du mépris) donne, justement, au récit, une légèreté inattendue. Parler avec des gros est tabou dans nos sociétés, si ouvertes sur d’autres sujets.
Gabrielle Deydier est attachante dans sa sincérité. Surtout le lecteur rencontre une figure charismatique, un trait souvent refusé aux personnes concernées. La copine grosse est souvent drôle et imposante. Jamais puissante. Pas assez en tout cas.
Dans ce regard insensible que la société porte sur les gros, le récit de Gabrielle est salutaire et rare.
Pas étonnant, alors, que le livre ai été difficile à accoucher. « Oui, écrire tout cela a été super dur », confie -t-elle.
Vivre sans s’excuser
Tout est bien sûr parti de la grossophobie. « Après avoir été méprisée et jugée pendant des années, j’ai décidé d’écrire pour ne plus m’excuser d’exister ». De la souffrance. De la bravoure aussi.
Son passage dans une école pour enfants sujets à des retards cognitifs de Neuilly-sur-Seine réveille ce « réflexe de survie », la poussant « à écrire les mots que ma bouche n’avait jamais su cracher ».
Après un entretien fleuve et ubuesque, la jeune femme est embauchée…à contrecœur.
On est en septembre 2014. Très vite, la professeure trentenaire, réputée revêche, passe les limites. « Je veux pas travailler avec une grosse », assène-t-elle.
Gabrielle ne flanche pas (encore). « C’est ton problème, pas le mien », rétorque, l’assistante fraichement recrutée. Les années d’humiliation rendent stoïques, aussi.
Sauf que l’enseignante est déterminée. Entre deux blagues racistes, elle lui annonce, avec délectation, sa convocation chez le principal. D’entretien, il s’avère que Gabrielle entre en procès.
“Double stigmate”
«Pour ces enfants déjà handicapés, vous êtes un double stigmate. Avoir une assistante comme vous, ça les stigmatise encore plus ».
Autre ignomie, « vous êtes montée en cours de SVT au deuxième étage, vous étiez très essouflée…Vous avez même transpiré dans la cour ».
Gabrielle répond, se défend, proteste. Mais difficile de rivaliser avec la mauvaise foi. Tant mieux, d’ailleurs.
Au chantage vil de l’amaigrissement contre emploi, Gabrielle à bout enchaîne les arrêts maladie. Une idée soufflée par le CPE :
« faites en sorte que votre médecin vous arrête jusqu’à la fin de votre contrat ».
Commence alors la fameuse « descente aux enfers » d’où surgi le besoin de raconter. De raconter, les crasses abjectes d’une société apeurée par tout ce qui ne fait pas « norme ».
Écrire pour naître
Mais des ténèbres émerge, parfois, une lumière inattendue. La rencontre aves ses éditeurs Geoffrey et Johann…en fut une.
En s’installant à Paris, Johan est la première personne qu’elle rencontre. Lors d’une soirée arrosée, elle enclenche sans le savoir, le processus d’écriture cathartique.
« Est-ce que vous savez ce que c’est que le grossophobie? », lance t-elle à ses futurs éditeurs.
L’ambiance est trop festive pour une discussion approfondie. « Fais-moi un mail, ça m’intéresse », répond Geoffrey entre deux éclats de rire. Le projet vient de naître.
Quelques jours plus tard, «je lui raconte mon parcours et mes humiliations ». Geoffrey lui propose d’écrire un livre. Pétrie de honte et de peur, elle refuse, hésite puis accepte. « Il m’a chaperonnée lors de l’enquête. J’ai dû affronter beaucoup de choses enfouies ».
De sujet parlé à parlant
Une épreuve salvatrice tant On ne naît pas grosse marque la réappropriation du sujet par les concerné.e.s.
L’ouvrage fait la tournée des grands ducs médiatiques. Le Monde jusqu’à la Une de The Observer en Grande-Bretagne. La grossophobie devient (enfin) un sujet audible. « Il paraît qu’en Scandinavie, je suis une star », s’amuse-t-elle.
A tel point que le tournage d’un téléfilm (France 3) débutera à l’automne. Un projet de documentaire devrait suivre tout comme une série. « Tout cela permet de combler quelques années de trou dans mon cv », ironise t-elle.
Et si le succès panse les plaies engendrées par la grossophobie, elle espère « aussi passer à autre chose. Je ne veux pas me résumer à cette fille grosse. Je ne suis pas que cela ».
L’importance de sortir de l’assignation à sujets. Surtout d’en parler avec acuité. Mais on est à l’an 1 de la question. Médiatiquement parlant.
Gros, mensonges et télé-réalité
Et face à la puissante télé-réalité, son livre est d’intérêt général. La polémique déclenchée par le projet d’émission de M6 et de Potiche Prod, animé par Karine Le Marchand et Cristina Cordula en est une illustration.
Les deux femmes, orfèvres de la téléréalité, comptent, à coup de lambeaux de chairs exhibés face caméra, mettre en scène la « Renaissance » des personnes obèses.
« Le problème n’est pas de parler de la chirurgie bariatrique. Mais quand on montre les gros comme des cas sociaux ou des loosers, que l’on fait croire que la chirurgie résout tout, c’est du freak show ».
Le tort de Le Marchand et Cordula ? Se cantonner à « la lune de miel », terme utilisé par les psychiatres, pour qualifier la période post-opératoire de cette chirurgie.
Mais sait-on, par exemple, qu’une personne sur deux, concernée par cette chirurgie, divorce ? Sait-on, aussi, que le taux de suicide est quatre fois supérieur après la phase de lune de miel ?
Et puis, est-il besoin de rappeler la corrélation entre pauvreté et poids ? 30% des femmes concernées disposent d’un revenu mensuel de moins 450 euros contre 7% pour celles dotées d’au moins 4200 euros par mois.
Pas sûr que la télé-réalité affiche ces aspects peu enthousiasmants de la réalité. Et c’est bien le souci.
Alors, armée de ses mots, Gabrielle Deydier résiste à cette impudeur obscène qui place les « gros » au rang d’objets de foire.
Elle qui a toujours su qu’elle “serait écrivain” éclaire sa trajectoire, permettant au lecteur d’entrevoir avec elle, ses parts d’ombres mais aussi ses espoirs.
Sans jamais nier la réalité ni l’embellir. Et cela commence par le choix des mots.
« Il faut utiliser le mot gros. Parler d’obésité renvoie à un diagnostic médical ».
Elle, le sait, mieux que quiconque. Bien nommer les choses, c’est ajouter au bonheur du monde.