
Lutte contre l’islamophobie : entre altruisme désintéressé et ambition personnelle
Vincent Geisser est chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po Aix. Son dernier livre : Musulmans de France, la grande épreuve : face au terrorisme, éditions de l’Atelier (avec Omero Marangiu-Perria et Kahina Smail). Quinze ans après son ouvrage La Nouvelle islamophobie, il revient sur les questions que soulève aujourd’hui le terme. ENTRETIEN.
Nadia Henni-Moulaï : En 2003, vous avez publié La Nouvelle islamophobie aux éditions La Découverte, le premier livre en France sur ce thème. Cet ouvrage à contribué à introduire l’islamophobie dans le débat public. Près de quinze ans plus tard, quel est votre sentiment sur la lutte contre l’islamophobie?
 Vincent Geisser : Il vrai que quand j’ai écrit La Nouvelle islamophobie, je n’avais pas conscience qu’il provoquerait une telle polémique dans l’espace public. J’ai été surpris par l’ampleur et surtout la virulence de la controverse. Certains m’accusaient de faire le jeu de l’islamisme en interdisant toute critique de l’islam, d’autres me voyaient comme une sorte d’intellectuel justicier qui, pour la première fois, osait dénoncer ouvertement le racisme antimusulman.
Vincent Geisser : Il vrai que quand j’ai écrit La Nouvelle islamophobie, je n’avais pas conscience qu’il provoquerait une telle polémique dans l’espace public. J’ai été surpris par l’ampleur et surtout la virulence de la controverse. Certains m’accusaient de faire le jeu de l’islamisme en interdisant toute critique de l’islam, d’autres me voyaient comme une sorte d’intellectuel justicier qui, pour la première fois, osait dénoncer ouvertement le racisme antimusulman.
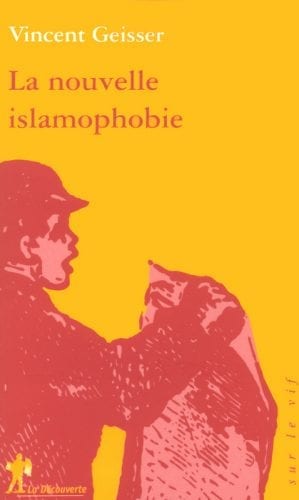 En somme, démon pour les uns, ange pour les autres. Or, mon intention première n’était pas de m’inscrire dans le débat idéologique mais de mettre l’accent sur les mutations des registres de stigmatisation dans la société française de ce début de XXIe siècle qui se sont en quelque sorte « islamisés ». La peur de l’immigré a été progressivement supplantée par la peur du « Beur de banlieue », puis par la peur du musulman, aboutissant à faire émerger en France et en Europe une « question musulmane ».
En somme, démon pour les uns, ange pour les autres. Or, mon intention première n’était pas de m’inscrire dans le débat idéologique mais de mettre l’accent sur les mutations des registres de stigmatisation dans la société française de ce début de XXIe siècle qui se sont en quelque sorte « islamisés ». La peur de l’immigré a été progressivement supplantée par la peur du « Beur de banlieue », puis par la peur du musulman, aboutissant à faire émerger en France et en Europe une « question musulmane ».
Avec du recul, je ne regrette pas la publication de cet ouvrage même si j’ai conscience des limites, des imperfections et des différentes formes d’instrumentalisation dont il a fait l’objet. Pour le dire franchement, j’ai été très rapidement débordé par le débat public et par les effets de diffusion du terme « islamophobie ». Il est vrai que de nombreux intellectuels, associations, mouvements et collectifs se sont emparés de ce terme pour le meilleur et pour le pire.
Le meilleur, c’est la prise de conscience publique des mutations sociales et idéologiques affectant les phénomènes racistes ; le pire, ce sont les récupérations communautaires*, et parfois mercantiles de l’islamophobie, à des fins de promotion sociale et personnelle. Il est clair que la lutte contre l’islamophobie est devenue une sorte de « niche communautaire » très lucrative qui permet à certains leaders d’opinion d’exister sur la scène publique.
N. H-M : Ces dernières années, le terme a souvent été au cœur de polémiques. Il a beaucoup accompagné le développement des réseaux sociaux. Qu’est-ce que cela dit selon vous ?
V.G. : Oui, il est vrai que si l’on tape le terme « islamophobie » sur les moteurs de recherche, l’on constate qu’il est aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux et qu’il est à l’origine de multiples discours, publications et mobilisations. Il y a incontestablement une « inflation » de ses usages sociaux. Mais comme toute inflation, il entraîne aussi un phénomène d’appauvrissement culturel et intellectuel.
Il a tendance à être utilisé dans tous les sens, sans véritable recul critique. Sur ce plan, je dirais que le « succès » du terme islamophobie est profondément ambivalent : il contribue à éveiller les consciences, tout en appauvrissant la compréhension du phénomène du racisme et des discriminations que certains acteurs tendent à réduire à la peur de l’islam et à la haine des musulmans.
Quid du racisme anti-Roms ? Quid des discriminations qui touchent les Noirs quelle que soit leur religion ? Quid de toutes les autres formes de stigmatisation sociale et raciale qui traversent aujourd’hui la société française ? De ce point de vue, la publicisation de la notion d’islamophobie a autant contribué à enrichir le débat public sur le racisme et les discriminations qu’à l’appauvrir.
N. H-M : La lutte contre l’islamophobie est aussi l’expression d’une génération qui a décidé de prendre la parole, d’élever la voix pour en finir avec ce racisme vécu par les parents. Qu’en dites-vous ?
V.G. : Il est certain que la lutte contre l’islamophobie a participé à renouveler la « galaxie antiraciste » et à susciter de nouvelles vocations militantes. « L’antiracisme de papa » a été secoué et ringardisé, parce qu’il était porté par des Français issus majoritairement des classes moyennes et supérieures qui étaient rarement confrontés eux-mêmes au racisme.
Il est vrai que les nouvelles générations issues des migrations postcoloniales ne se reconnaissent pas dans les organisations antiracistes classiques qui les a souvent ignorées et délaissées. Ils refusent en bloc cet antiracisme de type paternaliste qui prétend parler et lutter à leur place. Les jeunes victimes de racisme veulent se prendre en charge.
Sur ce plan, le nouveau militantisme contre l’islamophobie a été un facteur de rénovation du mouvement associatif antiraciste. Mais il a été aussi un facteur de segmentation, traduisant une renonciation partielle à un antiracisme universaliste.
Force est de constater que pointe actuellement une tendance à la communautarisation de l’antiracisme, chacun défendant sa propre « chapelle » : les organisations juives luttent exclusivement contre l’antisémitisme, les associations musulmanes contre l’islamophobie, les mouvements arméniens pour la reconnaissance du génocide, les Noirs contre la négrophobie, les homosexuels contre l’homophobie, etc. Si l’on prend le cas précis de la lutte contre l’antisémisme, l’on se rend compte que c’est devenu aujourd’hui un champ de concurrence effrénée entre leaders et organisations communautaires pour détenir le monopole du discours de dénonciation et la reconnaissance des pouvoirs publics.
Cette segmentation est dans l’air du temps et renvoie aussi à des logiques néolibérales qui favorisent l’émergence d’un marché concurrentiel de l’antiracisme en France, en détriment d’organisations universalistes. Il s’est produit un double processus de communautarisation et de mercantilisation du combat antiraciste.
N. H-M : La question de la fameuse convergence des luttes fait toujours débat. L’islamophobie, la négrophobie ou l’antisémitisme…Le morcellement des luttes est-il un symptôme ou une conséquence de cette incapacité à converger ?
V.G. : Ce morcellement des luttes antiracistes n’est pas dû simplement aux nouveaux militants et leaders mais aussi à l’incapacité totale des anciennes organisations à comprendre et à capter les aspirations des nouvelles générations.
Rappelez-vous la vive polémique provoquée au sein du MRAP (2003-2010) par l’introduction de la problématique de l’islamophobie. Le regretté Mouloud Aounit a été accusé de vouloir « islamiser » la lutte antiraciste par de nombreux militants et dirigeants de sa propre organisation.
Certains de ses anciens « camarades » l’ont même traité de « communautariste » sous prétexte que Mouloud Aounit voulait faire de la lutte contre l’islamophobie l’une des priorités du combat antiraciste.
Les torts sont donc partagés : les anciennes organisations n’ont pas su s’adapter aux mutations du racisme et les nouveaux militants ont parfois eu tendance à défendre un antiracisme exclusiviste : ma communauté d’abord !
N. H-M : Dans cet esprit, l’islamophobie a aussi permis l’émergence de nouveaux “leaders” et donc, par la force des choses, d’une forme de compétition. Faites-vous ce constat ?
Oui, je suis d’ailleurs assez critique sur ce point : la lutte contre l’islamophobie est devenue une sorte de marché. J’oserais presque employer la formule d’ « islamophobie business », au risque de déplaire. Elle a suscité des vocations militantes sincères et désintéressées (j’en connais beaucoup) mais aussi des ambitions personnelles et des désirs de mobilité sociale et professionnelle rapides.
N. H-M : Le terme “business” est un peu fort…
Il est évident que certains leaders utilisent aujourd’hui le créneau de l’islamophobie pour se faire une place et obtenir une notoriété publique, avec une empathie minimale pour les victimes des discriminations.
Mais ce phénomène est aussi vérifiable dans le monde universitaire et intellectuel : en 2003, personne ne voulait travailler sur l’islamophobie ; en 2017, c’est devenu presque un phénomène de mode. Nous sommes dans une société de plus en plus individualiste et néolibérale, et la lutte contre l’islamophobie n’échappe pas à ses tendances à l’ubérisation.
N. H-M : On peut parler de la question de “l’assignation à combat”…justement dans laquelle s’enferment les acteurs/actrices de la lutte contre l’islamophobie?
V.G. : En tant que citoyen et universitaire, je ne critique pas le bienfondé du combat contre l’islamophobie. Je fais simplement un constat : celui de la segmentation de la lutte antiraciste et, corrélativement, la renonciation à créer des espaces de lutte communs.
L’antiracisme universaliste ne fait plus rêver car il est trop difficile à conceptualiser et surtout à mettre œuvre. Aujourd’hui, il est plus facile de créer une organisation luttant exclusivement contre l’homophobie, l’antisémitisme ou l’islamophobie, etc. que d’imaginer des espaces de luttes à la fois dialogiques et transversaux.
Il existe un certain confort social et intellectuel, signe d’une paresse militante, à s’engager dans des causes exclusives, sans penser la transversalité. C’est l’air du temps : être efficace et visible sur le court terme, passer dans les médias, être célèbre, être vu su BFM et LCI ! C’est en ce sens que je parle d’anti-islamophobie de marché ou plutôt de lutte contre l’islamophobie mercantile.
N. H-M : Aujourd’hui, il semble difficile de drainer des soutiens à ce combat en dehors des musulmans. Une incapacité à mobiliser au-delà des musulmans. Comment rendre la lutte contre l’islamophobie “mainstream”?
V.G. : Il est clair que le combat contre l’islamophobie n’est pas pleinement légitime et qu’il suscite encore de nombreuses résistances chez certaines élites médiatiques, politiques et intellectuelles françaises qui l’assimilent de manière simpliste à une légitimation de l’islamisme.
Selon elles, dénoncer l’islamophobie, ce serait faire le jeu du fondamentalisme, du radicalisme religieux, voire du djihadisme ! Elles refusent donc d’employer cette notion d’islamophobie et luttent même pour son exclusion définitive de la langue française !
Mais il existe aussi des myopies musulmanes à ne voir le racisme que chez les autres, et à faire de l’islamophobie un combat exclusif, en oubliant tous les autres.
Le problème n’est donc pas tant dans la légitimation du terme « islamophobie » – à juste titre, celui-ci doit pouvoir être discuté et critiqué – mais dans la refondation de notre mythe national qui prenne en compte désormais une certaine forme d’islamité comme une composante légitime de la francité et qui arrête de considérer l’islam comme une religion étrange ou, pire, porteuse d’étrangeté !
La réforme n’est pas tant sémantique ou juridique mais touche davantage les mentalités afin de casser nos myopies réciproques et d’enrayer ce processus de segmentation sociale et raciale qui caractérise la société française de ce début de XXIe siècle.
Propos recueillis par Nadia Henni-Moulaï
*Note indicative : “Par communautaire, j’entends le sentiment de co-appartenance des individus à un une groupe social mu par une mémoire et des valeurs supposées communes, etc. Mais les frontières de ce groupe sont souvent très mouvantes et font l’objet de reconstruction permanente. C’est pour cette raison que les identifications communautaires renvoient souvent à des communautés imaginées.”
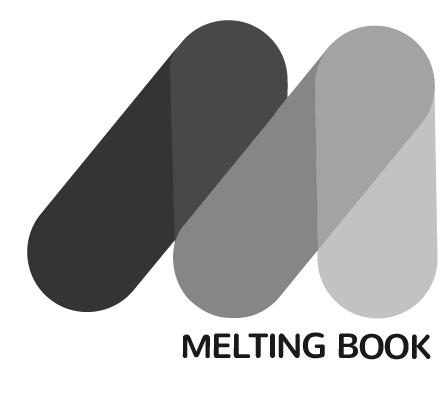
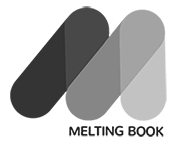



Chabani
Bravo vous avez mis les mots sur mes pensées et convictions.
Report