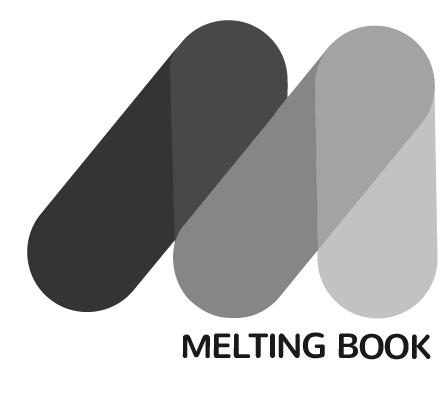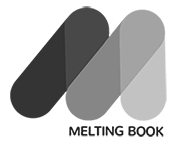Que signifie le terme “Ijtihâd” ?
[#Série d’analyses]
MeltingBook publie en exclusivité une série de 10 analyses tirées du livre : Abécédaire du jihadisme post-daesh : Analyses Témoignages Perspectives (2018). Un ouvrage collectif sous la direction de Moussa Khedimellah.
La quatrième analyse : celle d’Omero Marongiu-Perria, docteur en sociologie de l’ethnicité et des religions, spécialiste de l’islam français. L’auteur donne des clés de compréhension pour mieux appréhender le notion d’ijtihâd. Le mot renferme un effort intellectuel, pour rendre la religion plus intelligible et plus simple aux croyants.
Le terme Ijtihâd – ou idjtihâd – est utilisé par les musulmans pour signifier l’effort qu’un théologien fournit pour interpréter la religion. Dans son sens le plus large, il peut concerner tous les efforts qu’une personne déploie dans les domaines divers et variés de la vie religieuse ou profane.
Dans son sens plus restreint, qui vise spécifiquement le domaine religieux, il vise la démarche du savant pour extraire une norme des textes religieux de l’islam – le Coran et la tradition prophétique -, ou pour donner une interprétation de ces textes.
Du jihâd à l’ijtihâd, des notions à préciser
Le terme ijtihâd est dérivé du terme jihâd – ou djihâd -, qui exprime la notion d’effort. Pour couper court à toute confusion sur le sens du terme, posons d’emblée et une fois pour toutes que jihâd ne signifie pas, en arabe, guerre, et encore moins guerre sainte.
Pour la petite parenthèse, il faut savoir également que le terme jihâd est mentionné 36 fois dans le Coran, soit sous sa forme verbale jahada, soit sous sa forme nominale. Il désigne tout simplement l’effort que les adeptes du message de Muhammad doivent déployer pour se protéger des agressions des tribus polythéistes arabes.
Les Arabes ayant une culture essentiellement orale, le jihâd se traduit donc avant tout par des joutes verbales, parfois très acerbes. Le Coran fait également allusion à l’effort physique pour la défense de la communauté des croyants qui ont quitté la Mecque sous la pression des tribus mecquoises.
Le combat armé, pour sa part, est qualifié dans le Coran de Qitâl, et le terme de ribât désigne spécifiquement les garnisons placées aux avant-postes, proches de l’ennemi potentiel ou réel.
Avec ces quelques précisions, on voit que ce qui nous est présenté de manière triviale et simpliste par les médias n’est, finalement, pas si simple que cela, en tout cas bien loin de l’image d’une religion axée sur la conquête et les meurtres des non musulmans.
C’est cette notion d’effort qui est au cœur du terme ijtihâd. Entendons ici avant tout effort intellectuel, pour rendre la religion plus intelligible et plus simple aux croyants. Derrière la simplicité du mot, c’est tout un appareil conceptuel et pratique qui se cache.
Faire de l’ijtihâd, pour le savant de l’islam, c’est mettre en œuvre une connaissance profonde de la langue arabe, de la logique grecque – à savoir l’étude de l’argumentation – des fondements du droit, au carrefour de la philosophie et de la théorie du droit, et de toute une batterie d’autres outils méthodologiques qui échappent au commun des musulmans.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il existe des théologiens musulmans spécialisés dans tous les disciplines du champ religieux. On en conviendra, nous sommes là bien loin de l’image d’Épinal de l’imam enturbanné et à la barbe hirsute qui déverse à tout-va des fatwas sans queue ni tête ! Là aussi, il faut éclaircir une confusion, celle qui consiste à affirmer qu’il n’existe pas de clergé en islam.
Si on entend par « clergé » l’institution qui regroupe les clercs, c’est-à-dire les hommes de religion, alors il existe bien en islam des clercs qui sont reconnus comme tels par leurs pairs et par les musulmans, et qui suivent un cursus ben déterminés pour être acceptés en qualité de savants.
>> À LIRE SUR MELTINGBOOK :
Les autres analyses du livre collectif : Abécédaire du jihadisme post-daesh : Analyses Témoignages Perspectives (2018)
« Hûr ‘în » les 72 vierges du Paradis, Fantasmes et stratégie de com de Daesh
La différence avec le catholicisme, par exemple, réside dans le fait que ce clergé n’est pas centralisé, on doit plutôt parler de « foyers » qui exercent une influence en islam sunnite comme en islam chiite.
Il serait trop long, ici, de retracer la longue histoire des règles de l’ijtihâd et des disciplines qui l’encadrent, mais il faut savoir que l’effort d’interprétation a existé du temps même de la prophétie muhammadienne.
Pour continuer à casser certains clichés sur une religion dont les adeptes suivraient aveuglément leur « gourou », une petite anecdote : les tribus arabes ne connaissaient pas d’État centralisé, et il n’était pas possible de les soumettre si ce n’est par la force physique ou la persuasion orale.
C’est pour cela que le Coran insiste sur le débat sur pour les questions relatives à Dieu et à la religion. Les premiers musulmans étaient loin de fréquenter le Prophète quotidiennement, et plusieurs traditions rapportent qu’ils étaient amenés à faire des efforts personnels d’interprétation des préceptes que Muhammad enseignait au gré des situations qu’ils rencontraient au quotidien.
Bien souvent, celui-ci se contentait de les orienter sans remettre en cause le principe même de cet effort d’interprétation personnel du croyant.
Où sont passées les clefs de la porte de l’ijtihâd ?
Il existe une idée couramment véhiculée aujourd’hui, chez les musulmans, selon laquelle « Ne fait pas de l’ijtihâd qui veut, car le musulman doit se référer obligatoirement aux savants pour connaître et appliquer les préceptes de l’islam. » Cette affirmation relève d’une confusion.
Certes, il est tout à fait normal qu’une religion possède des institutions et un clergé chargé de diffuser une doctrine, parfois plusieurs si ce clergé n’est pas centralisé, et encadrer la pratique du culte.
De ce point de vue, les savants de l’islam sont des personnes qui, après avoir étudié dans les domaines de la religion, sont destinés à prendre de multiples fonctions et à orienter les fidèles.
Cependant, en aucun cas les clercs n’ont pour fonction de se substituer au jugement personnel du croyant, ni même à se poser en intermédiaires dans sa relation à Dieu. Ce serait là entrer en contradiction avec la notion même de libre arbitre et de responsabilité individuelle devant Dieu, qui amène constamment à faire des choix personnels au quotidien.
D’un autre côté, le croyant n’a pas vocation à se substituer aux clercs pour étendre sa doctrine personnelle à l’ensemble de ses coreligionnaires, c’est le principe de base de la distinction des fonctions au sein de la société.
Lorsque l’Islam se diffuse sur une large étendue allant, grosso modo, de la frontière chinoise au sud de la France, au début du VIIIe s, l’ijtihâd est progressivement codifié en un ensemble des disciplines qui vont structurer la théologie, le droit et la philosophie musulmane.
Cela donnera naissance à une multitude d’outils permettant aux savants de faire évoluer la compréhension de l’islam, mais surtout de l’adapter à des contextes de vie parfois très différents.
Sur une période d’environ quatre siècles, on voit se consolider cinq grandes écoles de théologie (1) et près d’une dizaine d’écoles juridiques (2) en islam sunnite et chiite. La philosophie musulmane acquiert ses lettres de noblesses du VIIIe au XIe siècle, sous l’empire abbasside, avec une ouverture sur le monde, sur les arts et les lettres et sur la culture inégalée jusqu’à aujourd’hui.
Au carrefour du IXe et du Xe s. de notre ère, le philosophe musulman al- Fârâbî approfondit la majeure partie des sciences connues à son époque, il traduit et commente les philosophes grecs, notamment La République de Platon.
Pour illustrer la façon dont il interprète le monde, citons le fait que, dans son Recensement des sciences (3), il place la musique comme un sous-ensemble des mathématiques.
Si cela peut nous surprendre, aujourd’hui, il faut y voir simplement la concordance entre une vision de la perfection du son comme émanation du divin, et la nécessité de construire des instruments qui puissent restituer ces sons de la façon la plus harmonieuse.
Une simple illustration de la façon dont l’islam a pu éclore de personnages prodigieux.
On parle pourtant abondamment, dans la littérature contemporaine sur l’islam, de la « fermeture des portes de l’ijtihâd ». Cette idée, qu’aucun fait historique n’a jamais corroboré telle quelle, consiste à affirmer que des théologiens musulmans auraient décrété, au tournant du XIIe s., le fait que les « anciens » auraient parachevé l’interprétation de l’islam et que, désormais, il faudra se contenter de suivre et de commenter ce qu’ils ont produit.
Il n’y a jamais eu de réunions de théologiens qui auraient promulgué une chose pareille dans le monde musulman. Pourtant, une analyse historique affinée laisse apparaître qu’il y a bien eu un moment charnière, au XIIe s., au cours duquel des théologiens partisans d’une orthodoxie stricte vont s’en prendre frontalement à tout ce mouvement d’idées et d’ouverture sur le monde, considérant qu’il s’agissait là d’une perversion de l’islam originel.
Le personnage central, à cette époque, est Abû Hamîd al-Ghazâlî qui, avec le soutien des sultans seljoukides – nous sommes vers la fin de l’empire abbasside -, jette les bases d’une institution, la Nizâmiyyah, qui encadrera la formation et la reproduction des corps de clercs dans l’empire.
À partir de ce moment, la philosophie musulmane et tout ce qu’elle comporte comme volets sur l’éthique, sur les arts, etc. va progressivement tomber en désuétude au profit d’une vision de la religion centrée sur la « norme ».
Cette « réorientation » de la religion musulmane ne sera jamais réellement mise en cause, même lorsque les Ottomans entament des réformes profondes de l’empire à partir du XVIIIe siècle.
Pour ne pas conclure cette courte fresque historique, il est important de mentionner que les fondements de l’ijtihâd sont toujours présents en islam, et ils permettent à n’importe quel savant de mettre en œuvre son jugement critique sur la religion, quand bien même serait-il en confrontation avec une majorité d’autres savants sur des questions particulières.
De ce point de vue, aucune institution musulmane ne possède un quelconque droit de censure vis-à-vis d’un théologien qui, à partir de son propre dispositif interprétatif, diffuse son interprétation de la religion.
L’ijtihâd contemporain en débat
La situation actuelle du monde musulman indique cependant que nous sommes souvent loin de cette situation idéale où, comme durant les premiers siècles de l’islam, le foisonnement intellectuel et théologique serait la règle.
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation, aussi bien la période coloniale qui voit la déstructuration politique, culturelle et religieuse des sociétés musulmanes, que la décolonisation et l’émergence d’États totalitaires qui ont largement instrumentalisé des mouvements religieux fondamentalistes pour exercer un contrôle sur les populations musulmanes.
Nous laissons cette histoire aux historiens mais il y a un point, cependant, qui est assez problématique dans l’exercice de l’ijtihâd chez les théologiens musulmans contemporains, c’est l’idée selon laquelle l’évolution de l’islam se ferait à marche forcée par un « Occident dominant » qui voudrait absolument vider l’islam de ses soubassements doctrinaux pour en faire une religion complètement sécularisée.
A partir de ce prisme, c’est toute l’histoire de la civilisation musulmane qui est relue, déformée, réduite, pour ne pas dire purement et simplement effacée sur l’autel du nécessaire « retour à l’islam originel ». Ce discours, qui est véhiculé par les milieux salafistes mais aussi chez les partisans d’un islam totalisant, demeure enfermé dans le prisme colonial, en refusant de voir une réalité cruciale pour l’islam contemporain.
En effet, alors qu’ils étaient largement dominants lors des siècles d’expansion de l’islam, les musulmans ont su intégrer la plupart des éléments des sociétés conquises, donc dominées, pour faire émerger une civilisation particulièrement florissante : dans le domaine de l’écriture, de l’administration, de la gestion des affaires politiques, des arts et des lettres, de la philosophie, du droit, etc.
Aujourd’hui, pour que l’ijtihâd puisse de nouveau ancrer l’islam dans le monde, il faudra que les clercs et les doctrinaires de l’islam fassent le deuil d’une vision mythifiée de leur religion et qu’ils prennent en compte les mutations profondes qui ont changé la face du monde.
Par Omero Marongiu-Perria, docteur en sociologie de l’ethnicité et des religions, spécialiste de l’islam français. Il est chercheur associé à l’IPRA (Institut de recherche sur le pluralisme religieux et l’athéisme), groupe de recherche des universités de Nantes et de Le Mans, et il est directeur scientifique d’ECLEE (European Center for Leadership & Entrepreneurship Education), centre de formation et de recherche-action situé à Lille. Depuis plus de 15 ans, il développe son expertise et ses interventions dans les domaines de la non-discrimination et du management de la diversité en entreprise. Il est par ailleurs régulièrement sollicité pour donner des formations sur la laïcité et en prévention du radicalisme religieux.
Ouvrages :
Musulmans de France, la grande épreuve, Vincent GEISSER, Omero MARONGIU-PERRIA, Kahina SMAÏL
En finir avec les idées fausses sur l’islam et les musulmans, Omero MARONGIU-PERRIA.
NOTES UTILES
(1) Écoles juridiques : chacune des écoles de droit musulman. Les quatre écoles les plus célèbres de l’islam sunnites sont, par ordre d’antériorité, le hanafisme, fondée par al-Nu’mân ibn Thâbit, surnommé Abou Hanîfa (mort en 767), qui s’étend à la quasi-totalité du monde musulman non arabe ; le malékisme, du nom de son fondateur Mâlik ibn Anas (mort en 795), répandu au Maghreb et en Afrique noire ; le chaféisme, fondé par Muhammad ibn Idrîs al- Shâfi‘i (mort en 820), présent en Égypte mais surtout en islam asiatique ; le hanbalisme, fondé par Ahmad ibn Hanbal (mort en 855), appliqué dans une lecture très restrictive en Arabie saoudite. Une cinquième école, appelée « école littéraliste », fondée par Dâwûd al-Zhâhirî (mort en 884), est toujours étudiée dans les universités musulmanes, même si son influence n’a jamais été très étendue. L’islam chiite, pour sa part, est très diversifié, mais deux écoles juridiques s’y sont imposées : l’école ja’farite, fondée par l’imam Ja’far al-Çâdiq (702-765), il s’agit de la principale école de droit chez les chiites ; l’école zaydite, qui se réclame de l’imam Zayd ibn ‘Alî, l’arrière-petit-fils du quatrième calife, cousin et gendre du Prophète, ‘Alî ibn abî Tâlib. Le Yémen est le foyer principal du zaydisme, dont le contenu des ouvrages est le plus proche, du côté chiite, des écoles juridiques sunnites.
(2) Écoles de théologie : Il existe cinq grandes écoles théologiques dans l’islam sunnite, dont trois sont considérées par la majorité des théologiens sunnites comme orthodoxes et deux comme hétérodoxes. L’ash‘arisme est la plus répandue, il a été fondé par Abûl-Hassân al- Ash’arî (mort en 935) ; le maturidisme, fondé par al-Mâturîdî (mort en 944) s’est surtout répandu en islam asiatique ; l’école juridique hanbalite possède également une approche théologique spécifique. Les deux écoles hétérodoxes sont le mu’tazilisme, considéré comme l’école de la rationalité, qui perdure de nos jours en islam chiite, et le murdjisme, qui a disparu dès les premiers siècles de l’islam.
(3) Abû Nasr al-Fârâbî, Le recensement des sciences, Albouraq, 2015.